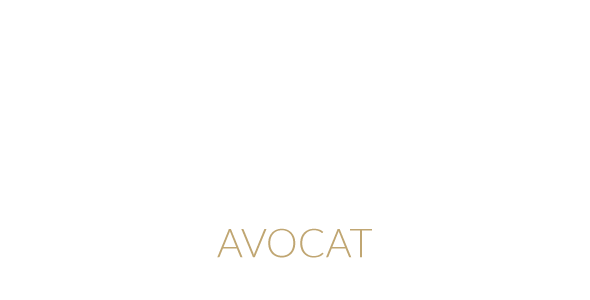Après des années d’expérimentation et de flou juridique, la circulation inter-files des deux-roues et trois-roues motorisés est enfin officiellement intégrée au Code de la route français. Le décret n° 2025-33 du 9 janvier 2025, entré en vigueur le 11 janvier 2025, légalise définitivement cette pratique sur l’ensemble du territoire national. Cette évolution majeure du droit routier français nécessite une compréhension précise des nouvelles règles applicables. Maître Minier, avocat expert en droit routier, vous explique tout.
- 1 Qu'est-ce que la circulation inter-files ?
- 2 Base légale : les modifications du Code de la route
- 3 Un processus de légalisation basé sur l'expérimentation
- 4 Où la circulation inter-files est-elle autorisée ?
- 5 Quels véhicules peuvent pratiquer la circulation inter-files ?
- 6 Les règles strictes de pratique
- 7 Sanctions en cas d'infraction
- 8 Conseils de sécurité pour les conducteurs
- 9 Impact sur la formation au permis de conduire
- 10 Bénéfices attendus de la réglementation
- 11 Perspectives d'évolution
- 12 Bilan après un an de légalisation (mise à jour janvier 2026)
- 13 En cas d'accident : aspects juridiques
- 14 F.A.Q. Circulation inter-files

Qu'est-ce que la circulation inter-files ?
La circulation inter-files (CIF) consiste pour les conducteurs de deux-roues et trois-roues motorisés à circuler entre deux files de véhicules lorsque la circulation est dense et que les véhicules roulent à vitesse réduite ou sont à l’arrêt. Concrètement, un motard ou un scootériste peut se faufiler entre les files de voitures dans les embouteillages, à condition de respecter un cadre réglementaire strict.
La CIF, largement répandue de facto depuis des décennies, était jusqu’alors tolérée dans certains départements, mais ne disposait d’aucun cadre légal clair. Sa légalisation répond à un besoin d’encadrement et de sécurisation d’un comportement déjà adopté par une majorité d’usagers de deux-roues motorisés.
Base légale : les modifications du Code de la route
Le décret n° 2025-33 du 9 janvier 2025 ne se contente pas de légaliser la circulation inter-files : il opère une refonte juridique complète en modifiant plusieurs articles fondamentaux du Code de la route pour lever les interdictions existantes et créer un cadre légal spécifique.
Articles du Code de la route modifiés
- Article R. 121-6 (Responsabilité pénale) – Modifié
L’ajout du « 17° La circulation en inter-files prévue à l’article R. 412-11-3 » permet la verbalisation par vidéo-verbalisation des infractions à la circulation inter-files, sans interception nécessaire.
- Article R. 412-9 (Obligation de circuler près du bord droit) – Modifié
L’article a été complété pour ajouter une exception spécifique : « dans les cas prévus à l’article R. 412-11-3 », exonérant ainsi les véhicules pratiquant la circulation inter-files de l’obligation de maintenir leur véhicule près du bord droit de la chaussée.
- Article R. 412-11-3 (Circulation inter-files) – Créé
Cet article entièrement nouveau établit le cadre juridique complet de la circulation inter-files : conditions d’autorisation, règles de pratique détaillées, sanctions spécifiques (contravention de 4e classe, retrait de 3 points, suspension possible du permis).
- Article R. 412-23 (Franchissement des lignes séparatives) – Modifié
L’adaptation de cet article autorise le franchissement des lignes entre voies dans le cadre de la circulation inter-files, alors que cette pratique était auparavant strictement interdite sauf pour les dépassements.
- Article R. 412-24 (Obligation de rester dans sa file) – Modifié
Cette modification lève l’interdiction de changer de file en cas de circulation dense, avec l’ajout explicite que « La circulation en inter-files est régie par l’article R. 412-11-3. »
Cette architecture juridique démontre que la légalisation de la circulation inter-files nécessitait une approche systémique pour adapter l’ensemble des règles de circulation existantes, créant ainsi un statut juridique particulier pour cette pratique.
Un processus de légalisation basé sur l'expérimentation
La légalisation de la circulation inter-files n’est pas le fruit d’une décision arbitraire. Elle résulte de deux campagnes d’expérimentation successives menées sous l’égide du CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement). La première expérimentation s’est déroulée de 2016 à 2021 dans 11 départements comprenant l’Île-de-France, les Bouches-du-Rhône, la Gironde et le Rhône. La seconde expérimentation, menée de 2021 à 2024, a étendu le périmètre d’étude à 21 départements.
Ces évaluations ont démontré une accidentalité stable et une bonne acceptation des règles par l’ensemble des usagers de la route, y compris les automobilistes. Le rapport final du CEREMA a validé les modalités d’une pratique sécurisée, ouvrant la voie à la généralisation sur l’ensemble du territoire français.
Où la circulation inter-files est-elle autorisée ?
L’article R.412-11-3 du Code de la route délimite précisément les zones d’application de la circulation inter-files. Cette limitation géographique répond à des impératifs de sécurité, la pratique n’étant autorisée que sur les infrastructures offrant les meilleures conditions de visibilité et de sécurité.
Types de voies autorisées
La circulation inter-files est exclusivement permise sur les infrastructures à haut niveau de service. Il s’agit principalement :
- des autoroutes avec au moins 2 voies par sens,
- des routes à chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins 2 voies chacune.
Ces infrastructures doivent présenter une vitesse maximale autorisée supérieure ou égale à 70 km/h.
Une exception importante concerne les routes où la vitesse a été abaissée par l’autorité de police locale, comme le périphérique parisien qui est passé de 70 à 50 km/h, mais reste autorisé pour la circulation inter-files.
Zones interdites
Inversement, de nombreuses zones restent strictement interdites à l’inter-files, notamment :
- les routes secondaires et voies urbaines classiques, car elles ne présentent pas les conditions de sécurité requises,
- les voies en travaux, les conditions de circulation y étant perturbées par la présence d’engins,
- les chaussées couvertes de neige ou de verglas,
- les tunnels et ouvrages d’art aux voies étroites où l’espace de manœuvre est réduit et la visibilité parfois limitée.
Quels véhicules peuvent pratiquer la circulation inter-files ?
La réglementation établit une distinction claire entre les véhicules autorisés et ceux qui en sont exclus. Cette limitation repose sur des critères techniques précis, notamment la largeur du véhicule, qui conditionne la sécurité de la manœuvre.
Conformément à l’article R.412-11-3 du Code de la route,
« tout conducteur d’un véhicule d’une largeur d’un mètre maximum relevant de la catégorie L3e ou L5e définie à l’article R.311-1 peut circuler entre les files de véhicules situées sur les deux voies. »
Véhicules autorisés
- Catégorie L3e : véhicules à deux roues sans side-car (article R.311-1, 4.3)
-
- L3e-A1 : motocyclettes ≤ 125 cm³, puissance ≤ 11 kW, ratio ≤ 0,1 kW/kg.
- L3e-A2 : motocyclettes ≤ 35 kW, ratio ≤ 0,2 kW/kg, non dérivées d’un modèle deux fois plus puissant.
- L3e-A3 : motocyclettes autres que A1 et A2 (> 35 kW).
- L3e-A1E, A2E, A3E : motocyclettes d’enduro homologuées et immatriculées.
- L3e-A1T, A2T, A3T : motocyclettes de trial homologuées et immatriculées.
👉 En pratique : motos et scooters classiques de plus de 50 cm³, hors side-cars.
- Catégorie L5e : véhicules à trois roues (article R.311-1, 4.5)
-
- L5e-A : tricycles destinés au transport de personnes (jusqu’à 5 places assises conducteur inclus).
- L5e-B : tricycles utilitaires (jusqu’à 2 places assises conducteur inclus).
👉 En pratique : scooters trois roues type Piaggio MP3, tricycles étroits destinés au transport de personnes ou à un usage utilitaire léger.
- Limites communes :
-
- Largeur maximale autorisée : 1 mètre (article R.412-11-3).
- Masse maximale pour les tricycles (L5e) : 1 000 kg (article R.311-1, 4.5).
Véhicules interdits
Ne peuvent pas circuler en inter-files :
- Side-cars (exclus de la catégorie L3e).
- Quads et quadricycles (catégorie L7e, non visée).
- Tricycles à voie large (> 1 m).
- Tout véhicule dépassant 1 m de largeur.
- Véhicules avec remorque ou équipement latéral.
Les règles strictes de pratique
La légalisation de la circulation inter-files s’accompagne d’un encadrement réglementaire strict. Ces règles, définies à partir des enseignements tirés des expérimentations successives, visent à garantir la sécurité de tous les usagers de la route tout en permettant aux deux-roues motorisés de bénéficier de cette possibilité.
Conditions de circulation
La pratique de l’inter-files n’est autorisée que dans des conditions très spécifiques. Le positionnement doit être exclusivement entre les deux files de véhicules situées le plus à gauche de la chaussée – sur une autoroute à trois voies, il s’agit donc de l’espace entre la voie de gauche et la voie centrale. Cette règle exige également un trafic dense, c’est-à-dire une circulation établie en files ininterrompues sur toutes les voies, et une vitesse des files ne dépassant pas 50 km/h.
Limitations de vitesse
Les limitations de vitesse constituent l’aspect le plus critique de la réglementation. La vitesse maximale pour le deux-roues en inter-files est fixée à 50 km/h, avec un différentiel de vitesse ne pouvant excéder 30 km/h par rapport aux véhicules en files. Un cas particulier s’applique lorsque l’une des files est à l’arrêt : la vitesse du deux-roues est alors limitée à 30 km/h pour garantir une sécurité maximale.
Interdictions spécifiques
Plusieurs comportements sont formellement proscrits. Il est interdit de dépasser un autre deux-roues circulant déjà en inter-files, de forcer le passage ou d’imposer sa présence aux autres usagers. Il est également obligatoire de cesser la circulation en inter-files dès que le trafic se fluidifie au-delà de 50 km/h.
Obligations du conducteur
Le conducteur doit respecter certaines obligations positives. Il doit signaler son intention avant de s’insérer en activant son clignotant, reprendre sa place dans une voie normale dès que le trafic redevient fluide, et maintenir en permanence une distance de sécurité suffisante avec les autres véhicules.
Sanctions en cas d'infraction
La légalisation de la circulation inter-files s’accompagne d’un régime de sanctions dissuasif. Cette approche répressive vise à garantir le respect des règles établies et à prévenir les comportements dangereux qui pourraient compromettre la sécurité des usagers.
Sanctions financières et administratives
Le non-respect des règles de circulation inter-files constitue une contravention de 4e classe sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de 3 points sur le permis de conduire.
Aggravation possible
En cas de comportement particulièrement dangereux ou de récidive, des sanctions complémentaires peuvent s’appliquer selon l’appréciation du tribunal, pouvant aller jusqu’à la suspension du permis de conduire dans les cas les plus graves.
Conseils de sécurité pour les conducteurs
La légalisation de la circulation inter-files nécessite une adaptation des comportements de l’ensemble des usagers de la route. Ces recommandations, issues des retours d’expérience des périodes d’expérimentation, visent à favoriser une cohabitation harmonieuse et sécurisée sur les routes.
Pour les motards et scootéristes
Les conducteurs de deux-roues motorisés doivent faire preuve d’une vigilance accrue en anticipant constamment les changements de direction des automobilistes qui peuvent ne pas les avoir vus. Le respect scrupuleux des limitations de vitesse demeure la clé de voûte de la sécurité, car c’est sur ce point que se concentrent les principaux risques, selon le rapport du CEREMA.
La signalisation des intentions par l’usage du clignotant est essentielle, tout comme le maintien d’une distance de sécurité suffisante pour pouvoir réagir en cas d’imprévu. Enfin, il convient d’adapter sa conduite aux conditions météorologiques et de visibilité, la circulation inter-files demandant une attention soutenue.
Pour les automobilistes
Les automobilistes jouent un rôle important dans la réussite de cette cohabitation. Les vérifications dans les rétroviseurs avant tout changement de file deviennent encore plus importantes, de même que le respect de l’espace en laissant suffisamment de place entre les files pour permettre le passage des deux-roues.
Cette évolution réglementaire demande de faire preuve de patience et d’accepter cette pratique désormais légale et réglementée. La signalisation claire des intentions de changement de direction reste fondamentale pour éviter les accidents.
Impact sur la formation au permis de conduire
Avec cette légalisation, la circulation inter-files peut désormais être intégrée dans les formations dispensées par les établissements d’enseignement de la conduite. Les auto-écoles peuvent maintenant sensibiliser les futurs automobilistes à cette pratique légale et aux comportements à adopter pour favoriser une cohabitation harmonieuse.
De leur côté, les moto-écoles ont désormais la possibilité d’enseigner concrètement les règles de la circulation inter-files à leurs élèves, ce qui représente une avancée majeure pour la sécurité routière. Cette formation initiale permettra aux nouveaux conducteurs de deux-roues de maîtriser cette technique dès l’obtention de leur permis.
Enfin, la formation continue bénéficie également de cette évolution, notamment dans le cadre des stages de récupération de points qui peuvent désormais intégrer des modules spécifiques sur la cohabitation avec les véhicules en circulation inter-files.
Bénéfices attendus de la réglementation
La légalisation de la circulation inter-files s’inscrit dans une démarche d’optimisation de la circulation routière et d’amélioration de la sécurité. Les bénéfices attendus, identifiés lors des phases d’expérimentation, concernent tant les conducteurs de deux-roues motorisés que l’ensemble des usagers de la route.
Pour les deux-roues motorisés
Cette réglementation apporte avant tout une sécurité juridique en mettant fin au flou réglementaire qui prévalait depuis des décennies. Les conducteurs de deux-roues bénéficient également d’une réduction significative des temps de trajet grâce à une meilleure fluidité en cas d’embouteillage, ce qui contribue à une diminution du stress lié à la circulation dense. La pratique étant désormais encadrée et reconnue, elle devient plus prévisible pour tous.
Pour l'ensemble des usagers
Au-delà des seuls deux-roues motorisés, cette mesure contribue à une fluidification générale du trafic en réduisant la congestion globale. La réglementation améliore la prévisibilité des comportements en établissant des règles claires que chacun peut anticiper. L’encadrement de la CIF participe également à l’amélioration de la sécurité routière en réduisant les comportements à risque liés à l’absence de réglementation.
Perspectives d'évolution
Le décret de janvier 2025 marque une étape importante mais pourrait évoluer selon les retours d’expérience collectés dans les mois et années à venir. Le développement d’une signalisation spécifique fait partie des pistes envisagées pour améliorer l’information des usagers et clarifier les zones d’application de la circulation inter-files.
Le renforcement des moyens de verbalisation constitue également un axe de travail privilégié par les pouvoirs publics, notamment à travers l’extension de la vidéo-verbalisation qui permet un contrôle plus efficace du respect des règles.
À plus long terme, une évaluation d’une extension à d’autres types de voies pourrait être envisagée, sous réserve que les retours d’expérience de cette première phase de généralisation soient positifs en termes de prévention des accidents.
Bilan après un an de légalisation (mise à jour janvier 2026)
Un an après l’entrée en vigueur du décret, la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) et la Ligue de Défense des Conducteurs (LDC) ont publié les résultats d’une enquête menée auprès de près de 650 usagers de la route.
Principaux enseignements :
– Deux tiers des répondants estiment que les règles encadrant la CIF ont amélioré les conditions de circulation dans les embouteillages ;
– Pour 30 % des sondés, la légalisation n’a rien changé par rapport à la pratique préexistante ;
– La communication gouvernementale est jugée insuffisante, notamment envers les automobilistes ;
– La FFMC appelle les pouvoirs publics à poursuivre leurs efforts de sensibilisation.
Le cadre juridique posé en janvier 2025 reste inchangé pour 2026. Aucune modification réglementaire n’est prévue à court terme, mais les pouvoirs publics continueront d’analyser les effets de cette légalisation sur l’accidentalité.
En cas d'accident : aspects juridiques
La légalisation de la circulation inter-files ne bouleverse pas les principes fondamentaux du droit de la responsabilité en matière d’accidents de la route. Cependant, elle introduit de nouveaux paramètres dans l’appréciation des responsabilités qui méritent d’être précisés.
Responsabilité
La légalisation de la circulation inter-files ne modifie pas les principes généraux de responsabilité en cas d’accident, mais ajoute de nouveaux critères d’évaluation. Chaque situation sera désormais évaluée en tenant compte du respect des règles de la CIF par le deux-roues (vitesse, positionnement, conditions de trafic), des manœuvres des autres véhicules (changements de file, signalisation), des conditions de circulation au moment de l’accident, ainsi que des témoignages et preuves disponibles pour reconstituer les faits.
Conseils en cas de sinistre
En cas d’accident impliquant un véhicule en circulation inter-files, il est recommandé de documenter minutieusement la scène en photographiant les dégâts et la position des véhicules, de recueillir les coordonnées des témoins présents, de préciser les circonstances exactes dans le constat amiable, et de consulter un avocat expert en droit routier si la situation présente des complexités particulières liées à l’application de la nouvelle réglementation.
La légalisation de la circulation inter-files marque une évolution pragmatique du droit routier français. Cette réglementation, fruit d’années d’expérimentation et d’analyse, offre un cadre clair pour une pratique largement répandue.
Le succès de cette mesure reposera sur le respect scrupuleux des règles par les conducteurs de deux-roues motorisés et sur l’acceptation de cette pratique par l’ensemble des usagers de la route. La sécurité routière reste l’objectif prioritaire, nécessitant une vigilance constante de tous.
Pour toute question spécifique relative à l’application de ces nouvelles règles ou en cas de litige, n’hésitez pas à consulter un professionnel du droit routier.
F.A.Q. Circulation inter-files
Oui, depuis janvier 2025. Bien que limité à 50 km/h, le périphérique reste autorisé car il s’agit d’une infrastructure à chaussées séparées par un terre-plein central.
Non. Si l’une des files est à l’arrêt complet, votre vitesse est limitée à 30 km/h maximum pour garantir la sécurité.
Vous risquez une contravention de 4e classe : 135 euros d’amende + 3 points de permis retirés. La verbalisation peut se faire par vidéo sans interception.
La responsabilité dépend du respect des règles par chaque conducteur. Le fait de circuler légalement en inter-files ne dégage pas automatiquement de toute responsabilité.
Oui, puisque la pratique est désormais légale. Cependant, le non-respect des règles de la CIF peut influencer l’évaluation des responsabilités.
Oui, s’il fait moins d’un mètre de large et appartient à la catégorie L5e. Les side-cars et quads sont interdits.
Non, c’est formellement interdit. Il faut attendre qu’il reprenne sa place dans une file normale.