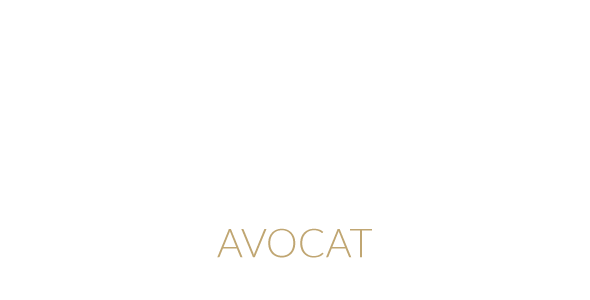La récidive en droit pénal routier a récemment fait l’objet de précisions importantes, à la fois jurisprudentielles et législatives.
Par un arrêt du 11 juin 2025 (pourvoi n° 24-84.081), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que la récidive légale ne peut être étendue au-delà des prévisions expresses de la loi. Quelques semaines plus tard, la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, créant l’« homicide routier », est venue élargir la liste des infractions routières assimilées au regard de la récidive.
Maître Minier, avocat en droit routier et en droit pénal, intervient sur tout le ressort de la Cour d’appel de Nîmes. Il vous explique l’articulation entre cette jurisprudence et la réforme récente, ainsi que leurs conséquences pour les conducteurs poursuivis en état de récidive.
- 1 Qu’est-ce que la récidive en droit pénal routier ?
- 2 Les différents types de récidive
- 3 La récidive délictuelle routière avant la réforme de 2025
- 4 Depuis la loi du 9 juillet 2025 : une réforme majeure
- 5 Quelles sanctions en cas de récidive d’une infraction routière ?
- 6 Quelles implications pour la défense ?
- 7 F.A.Q. Récidive en droit pénal routier

Qu’est-ce que la récidive en droit pénal routier ?
La récidive routière ne se résume pas à « commettre deux fois la même faute ». Elle obéit à des règles précises, différentes de la simple réitération d’infraction.
La distinction entre réitération et récidive
La récidive légale, strictement encadrée par les articles 132-8 à 132-16 du Code pénal, se distingue de la simple réitération d’infraction.
La réitération sanctionne toute nouvelle infraction, tandis que la récidive exige davantage : identité ou assimilation des infractions, délai déterminé, caractère définitif de la première condamnation.
Cette distinction emporte des conséquences majeures : contrairement à la réitération qui n’engendre aucune aggravation, la récidive double les peines maximales risquées.
Les fondements juridiques de la récidive
L’article 132-10 du Code pénal dispose :
« Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive. »
Les différents types de récidive
Le Code pénal distingue plusieurs formes de récidive, avec des délais et des conséquences différentes.
La récidive générale et perpétuelle (article 132-8 CP)
En matière criminelle, la récidive est sans limites de temps. Ainsi, après une condamnation définitive pour crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, tout nouveau crime, même plusieurs décennies plus tard, constitue une récidive.
Article 132-8 du Code pénal : « Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet un crime »
Cas pratique : Marc est condamné en 2000 pour trafic de stupéfiants (délit puni de 10 ans). En 2025, il commet un homicide volontaire (crime). Bien que 25 ans se soient écoulés, Marc est en état de récidive perpétuelle. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité au lieu des 30 ans normalement prévus.
La récidive générale et temporaire (article 132-9 CP)
Deux hypothèses se présentent ici à nous. La récidive générale et temporaire existe lorsque, après une condamnation pour crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, l’auteur commet :
- un délit puni de 10 ans d’emprisonnement dans un délai de dix ans à compter de la première condamnation définitive ;
- ou un délit puni d’une peine comprise entre 1 et 9 ans d’emprisonnement dans un délai de 5 ans.
Article 132-9 alinéa 1 du Code pénal : « Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine »
Article 132-9 alinéa 2 du Code pénal : « Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans »
Cas pratique : Sophie est condamnée en 2020 pour escroquerie en bande organisée (délit puni de 10 ans) à 3 ans de prison ferme. En 2023, elle commet des violences volontaires (délit puni de 3 ans). L’infraction étant commise dans les 5 ans suivant l’expiration de sa peine, Sophie est en récidive générale temporaire. Elle encourt 6 ans au lieu de 3.
La récidive spéciale temporaire (article 132-10 CP)
Elle suppose que la seconde infraction soit la même que la première ou une infraction assimilée et qu’elle soit commise dans un délai de 5 ans.
Article 132-10 du Code pénal : « Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive »
Cas pratique : Paul est condamné en 2022 pour conduite en état d’ivresse (L.234-1 du Code de la route) à 6 mois de prison avec sursis. En 2024, il est contrôlé pour conduite sans permis (L.221-2 du Code de la route). Ces deux infractions étant assimilées par l’article 132-16-2 du Code pénal et commises dans les 5 ans, Paul est en récidive spéciale temporaire. Il encourt 4 ans au lieu de 2.
| Première infraction | Seconde infraction | Délai |
|---|---|---|
| Délit | Délit identique ou assimilé | 5 ans |
| Crime ou délit puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement | Délit puni entre 1 et 9 ans d’emprisonnement | 5 ans |
| Crime ou délit puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement | Délit puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement | 10 ans |
| Délit ou crime puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement | Crime | Illimitée |
La récidive délictuelle routière avant la réforme de 2025
Avant juillet 2025, la liste des infractions routières concernées par la récidive était particulièrement restrictive. L’arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2025 (pourvoi n° 24-84.081) illustre parfaitement les limites de l’ancienne législation.
L’ancien article 132-16-2 du Code pénal
Avant la réforme, l’article 132-16-2, alinéa 2, listait les délits routiers suivants, considérés comme une même infraction :
- L.221-2 : Conduite sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule.
- L.233-1 : Refus d’obtempérer (refus de s’arrêter à une sommation des forces de l’ordre).
- L.233-1-1 : Refus d’obtempérer aggravé (lorsque le refus est commis dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou d’infirmité, ou créant un accident).
- L.234-1 : Conduite sous l’emprise de l’alcool ou en état d’ivresse manifeste.
- L.235-1 : Conduite après usage de stupéfiants.
- L.413-1 : Grand excès de vitesse en récidive (plus de 50 km/h).
Illustration jurisprudentielle : l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2025
Les faits du dossier
Un conducteur était poursuivi pour une conduite malgré annulation du permis de conduire en récidive. La Cour d’appel de Bourges a déclaré le prévenu en état de récidive légale. Elle se fondait notamment sur une condamnation antérieure du 18 novembre 2021 pour « conduite sans permis ».
La solution retenue : rejet de l’assimilation
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges.
Motif : « le délit de conduite sans permis, prévu par l’article L.221-2 du Code de la route, et le délit de conduite malgré annulation judiciaire du permis, prévu par l’article L.224-16 du même code, ne sont pas assimilés au regard de la récidive ».
L’interprétation stricte des textes
Règle d’or en matière d’application de la loi pénale prévue par l’article 111-4 : « La loi pénale est d’interprétation stricte. »
Cette décision illustre parfaitement l’application du principe d’interprétation stricte des règles de récidive.
La haute juridiction rappelle que l’assimilation entre infractions au regard de la récidive ne peut résulter que d’une disposition expresse prévue par le Code pénal.
Depuis la loi du 9 juillet 2025 : une réforme majeure
La réforme de juillet 2025 (loi n° 2025-622) engendre un net élargissement du champ d’application de la récidive légale routière. Le législateur a élargi le champ des infractions assimilées et créé le nouveau délit d’homicide routier.
L’élargissement des infractions assimilées
La réforme a élargi la liste des infractions assimilées. L’article 132-16-2, alinéa 2, vise désormais aussi :
- L.223-5 : Refus de soumettre à l’injonction de restituer son permis après invalidation
- L.224-16 : Conduite malgré annulation, suspension, invalidation ou interdiction du permis.
- L.224-17 : Refus de restituer son permis après annulation ou suspension.
- L.234-8 : Refus de se soumettre aux vérifications alcoolique.
- L.234-16 : Conduite sans ethylotest anti-démarrage
- L.235-3 : Refus de se soumettre aux vérifications stupéfiantes.
- 434-41 C. pénal : Conduite d’un véhicule malgré interdiction judiciaire.
L’articulation avec le nouveau délit d’homicide routier
⚠️ Attention, ces délits routiers sont également assimilés aux délits d’homicide ou de blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, mais uniquement lorsqu’ils constituent le second terme de la récidive.
Quelles sanctions en cas de récidive d’une infraction routière ?
Être déclaré en état de récidive n’a rien d’anodin. La loi prévoit un régime particulièrement sévère : les peines principales sont doublées, les peines complémentaires sont aggravées, dont certaines qui deviendront automatiques (confiscation du véhicule et annulation du permis).
Le doublement des peines principales
En matière de récidive, les maxima prévus par la loi sont automatiquement doublés.
Exemples :
- Conduite sans permis : 1 an et 15 000 € → 2 ans et 30 000 € en récidive.
- Conduite sous alcool : 2 ans et 4 500 € → 4 ans et 9 000 € en récidive.
- Grand excès de vitesse : 3 mois et 3 750 € → 6 mois et 7 500 € en récidive.
Ce mécanisme traduit la volonté du législateur de sanctionner plus sévèrement la récidive en matière routière.
Des peines complémentaires automatiques
À côté des peines principales, la récidive entraîne un alourdissement systématique des sanctions accessoires :
- annulation automatique du permis avec interdiction de solliciter d’en solliciter un nouveau.
- confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction.
L’inscription au casier judiciaire
Enfin, les condamnations pour récidive délictuelle font l’objet d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Cette mention peut avoir des répercussions concrètes sur la vie professionnelle : refus de recrutement dans la fonction publique, impossibilité d’exercer certaines professions réglementées, difficultés particulières pour les métiers liés à la conduite (chauffeurs, livreurs, VTC).
Quelles implications pour la défense ?
Être poursuivi en état de récidive n’est pas une fatalité. L’avocat dispose de plusieurs leviers pour vérifier que les conditions légales soient bien réunies et, le cas échéant, contester l’assimilation. L’examen doit porter sur plusieurs points essentiels :
La qualification exacte des infractions
La première et la seconde condamnation doivent parfois être distinguées. Cette vérification est essentielle en raison des subtilités de l’article 132-16-2 du Code pénal, qui prévoit deux régimes d’assimilation différents.
Son alinéa 1 vise les délits d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité commis à l’occasion de la conduite (articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal). Ces infractions ont une particularité : elles peuvent constituer le second terme d’une récidive avec d’autres infractions routières, mais jamais le premier terme.
👉 Concrètement, une personne condamnée pour homicide routier ne pourra pas être considérée en récidive si elle commet ensuite une conduite sans permis. En revanche, une personne déjà condamnée pour conduite sans permis (L.221-2) sera en récidive si elle commet ensuite un homicide routier.
Cette asymétrie s’explique par la nature involontaire de ces infractions : le législateur n’a pas souhaité qu’un accident, même grave, puisse aggraver la situation pénale d’un conducteur pour des infractions volontaires ultérieures.
L’existence d’une assimilation légale expresse entre ces infractions
Le juge peut et doit relever d’office la récidive : La Cour de cassation maintient la faculté pour le juge de relever d’office cette circonstance, à condition de respecter le principe du contradictoire.
Le respect du délai de cinq ans prévu par l’article 132-10
Détermination du point de départ du délai : Le délai de récidive court à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, non à partir du jour où la première condamnation est devenue définitive.
Le caractère définitif de la première condamnation
Impact des condamnations réhabilitées : Une condamnation réhabilitée de plein droit constitue un élément de personnalité. Elle peut être prise en considération lors de l’examen de la culpabilité ou de la peine (Cass. crim., 7 mai 2025).
La récidive en matière routière entraîne un doublement automatique des peines et expose à des sanctions complémentaires particulièrement lourdes : annulation du permis, confiscation du véhicule, inscription au casier judiciaire.
Face à ces lourdes conséquences, la défense doit être préparée avec soin. Un avocat expert en droit pénal routier pourra :
- vérifier si les conditions légales de la récidive sont réellement réunies,
- identifier les subtilités liées aux assimilations prévues par l’article 132-16-2,
- soulever les irrégularités de procédure ou les erreurs de qualification,
- accompagner le conducteur dans l’exercice des recours (appel, pourvoi en cassation, demande de relèvement).
En pratique, consulter un avocat dès la garde à vue ou dès la convocation devant le tribunal est souvent décisif. Une intervention rapide permet d’anticiper les risques, de préparer une défense adaptée et, dans certains cas, d’éviter la récidive ou d’en limiter les conséquences.
F.A.Q. Récidive en droit pénal routier
En matière délictuelle routière, le délai est de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la première peine. Passé ce délai, une nouvelle infraction ne constitue plus une récidive, mais une simple réitération.
Oui, mais uniquement entre contraventions de 5e classe commises dans un délai d’un an. Les contraventions ne peuvent pas être assimilées aux délits.
Non, l’exécution d’une composition pénale équivaut à une condamnation pour l’application des règles de récidive.