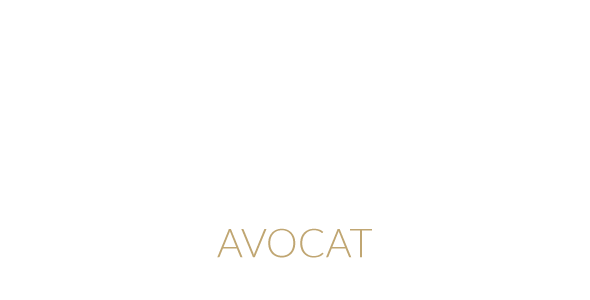Les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) équipent désormais obligatoirement tous les véhicules neufs depuis juillet 2024. Entre promesses de sécurité accrue et dysfonctionnements médiatisés, comme les « freinages fantômes », ces technologies soulèvent des questions juridiques : qui est responsable en cas d’accident ? Peut-on désactiver ces systèmes ? Quels sont vos droits et obligations ? Maître Minier, expert en droit routier, répond à toutes ces interrogations.
- Les ADAS désormais obligatoires : ce que dit la réglementation GSR2
- La responsabilité en cas d’accident : le conducteur reste maître à bord
- Freinages fantômes : quand les systèmes d’aide à la conduite dysfonctionnent
- Peut-on légalement désactiver les ADAS ?
- L’évolution prévisible : vers les véhicules autonomes
- Vos droits en cas de dysfonctionnement d’un système d’aide à la conduite (ADAS)
- Recommandations pratiques pour les conducteurs
- F.A.Q. Systèmes d’aide à la conduite (ADAS)

Les ADAS désormais obligatoires : ce que dit la réglementation GSR2
Depuis le 7 juillet 2024, le Règlement européen 2019/2144, dit General Safety Regulation 2 (GSR2), impose l’installation obligatoire de nombreux systèmes avancés d’aide à la conduite sur tous les véhicules neufs immatriculés dans l’Union européenne. Cette obligation, qui s’appliquait déjà aux nouveaux types (c’est-à-dire les modèles nouvellement homologués) depuis juillet 2022, marque un tournant majeur dans la sécurité routière.
Concrètement, cela se traduit par une série d’équipements que tous les constructeurs doivent désormais intégrer dans leurs modèles, afin de renforcer la sécurité routière et protéger les usagers.
Liste officielle des équipements obligatoires (véhicules M1 et N1)
Conformément à l’annexe II du Règlement (UE) 2019/2144, les véhicules particuliers (M1) et utilitaires légers (N1) doivent être équipés notamment de :
- le freinage automatique d’urgence (AEB), incluant la détection des piétons et cyclistes, pour réduire les risques de collision ;
- le système d’urgence de maintien de voie (ELKS), qui corrige la trajectoire en cas de franchissement involontaire ;
- l’adaptation intelligente de la vitesse (ISA), qui informe le conducteur des limitations de vitesse et peut intervenir pour éviter les excès ;
- l’alerte de somnolence (DDAW), obligatoire dès 2022 pour les nouveaux types, généralisée depuis juillet 2024 ;
- l’alerte avancée de distraction du conducteur (ADDW), obligatoire pour les nouveaux types depuis juillet 2024 et généralisée à partir de juillet 2026 ;
- l’enregistreur de données d’événements (EDR), véritable « boîte noire » enregistrant les paramètres essentiels du véhicule en cas d’accident ;
- le signal de freinage d’urgence (ESS), qui active automatiquement les feux en cas de freinage brutal pour alerter les usagers suivants ;
- la détection en marche arrière (caméra ou capteurs), destinée à éviter les collisions avec piétons, cyclistes ou obstacles invisibles ;
- l’interface normalisée pour éthylotest antidémarrage (interface EAD), qui permet d’installer facilement un dispositif EAD lorsque la justice en impose l’usage.
Les objectifs européens de sécurité routière : ambitions et réalités
L’objectif initial de l’Union européenne était de réduire de 50% le nombre d’accidents mortels et de blessés graves d’ici 2030. Plus spécifiquement, les technologies ADAS obligatoires du règlement GSR2 devaient à elles seules contribuer à sauver plus de 25 000 vies et éviter au moins 140 000 blessés graves d’ici 2038, selon les estimations du Parlement européen.
Toutefois, selon le rapport de la Cour des comptes européenne de mars 2024, ces objectifs ambitieux ne seront probablement pas atteints : la réduction du nombre de victimes ne devrait diminuer que de 25 %, ce qui compromettrait l’objectif final de mortalité routière proche de zéro en 2050.
La responsabilité en cas d'accident : le conducteur reste maître à bord
La multiplication des ADAS pose une question fondamentale : qui est responsable lorsqu’un accident survient alors qu’un système d’aide à la conduite était actif ? La réponse juridique est claire, mais peut surprendre.
Le principe : la responsabilité du conducteur demeure entière
Malgré la sophistication croissante des aides à la conduite, le droit français maintient fermement le principe de la responsabilité du conducteur. Cette position s’appuie sur plusieurs fondements juridiques :
- L’article R412-6 du Code de la route : « Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. »
- La loi Badinter du 5 juillet 1985 : elle continue de s’appliquer pleinement, désignant le conducteur ou le gardien du véhicule comme responsable de l’indemnisation des victimes.
- Les ADAS restent des « aides » : juridiquement, ils correspondent au maximum au niveau 2 d’automatisation (classification SAE, qui va de 0 à 5), c’est-à-dire un stade où le conducteur doit en permanence superviser la conduite et garder le contrôle du véhicule.
⚠️ Attention
Le fait qu’un système ADAS était actif au moment de l’accident ne constitue pas une cause d’exonération de la responsabilité du conducteur. Vous restez juridiquement responsable même si le freinage automatique ne s’est pas déclenché ou si le maintien de voie a dysfonctionné.
La difficile recherche de la responsabilité du constructeur
Si la responsabilité du conducteur reste le principe, celle du constructeur automobile peut théoriquement être engagée, mais les conditions sont restrictives :
- Sur le fondement des produits défectueux (articles 1245 et suivants du Code civil) : il faut prouver un défaut du produit, un dommage et un lien de causalité.
- La preuve du défaut : elle s’avère particulièrement complexe pour les systèmes ADAS, nécessitant souvent une expertise technique approfondie.
- Le risque de développement : le constructeur peut s’exonérer en prouvant qu’en l’état des connaissances scientifiques et techniques lors de la mise en circulation, il était impossible de déceler le défaut.
Freinages fantômes : quand les systèmes d’aide à la conduite dysfonctionnent
Depuis début 2025, un phénomène inquiétant prend de l’ampleur : les « freinages fantômes ». Il s’agit de freinages intempestifs déclenchés par les systèmes AEB sans danger réel, créant paradoxalement des situations accidentogènes.
L'ampleur du phénomène
Face à la multiplication des signalements, le ministère des Transports a officiellement confirmé le 15 août 2025 l’ouverture d’une enquête via le Service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM). Cette décision fait suite aux alertes portées notamment par Joanna Peyrache, reçue par les services ministériels le 7 août 2025.
Selon les témoignages recueillis par cette lanceuse d’alerte, plusieurs centaines de cas auraient été signalés en quelques semaines, concernant des véhicules récents (2017-2025) de diverses marques. Stellantis (regroupant Peugeot, Citroën, DS) fait partie des constructeurs contactés par les autorités dans le cadre de cette enquête. Le SSMVM a annoncé qu’il procédera à des essais en conditions représentatives pour évaluer objectivement le comportement de ces systèmes.
💡 À noter : les véhicules les plus récents sont désormais équipés d’un enregistreur de données d’événements (EDR), véritable « boîte noire » automobile. En cas de freinage fantôme, l’EDR peut fournir une preuve objective en enregistrant si le freinage a été déclenché par le système AEB ou par le conducteur lui-même. Ces données objectives peuvent être déterminantes pour appliquer les principes de responsabilité (article R412-12 du Code de la route) et renverser, le cas échéant, la faute présumée du suiveur.
Conséquences juridiques des freinages fantômes
Au-delà de l’enquête technique, ces situations posent une question centrale : qui est responsable en cas d’accident causé par un freinage fantôme ?
En cas de collision arrière causée par un freinage fantôme, le principe constant en droit routier considère que c’est le véhicule suiveur qui est présumé responsable pour non-respect des distances de sécurité (article R412-12 du Code de la route, qui précise désormais la règle des 2 secondes).
Cette présomption peut toutefois être renversée si le conducteur du véhicule suiveur parvient à prouver une faute caractérisée du véhicule qui le précède, telle que :
- une insertion brutale après dépassement sans respecter les distances de sécurité ;
- un freinage volontaire abusif (par exemple pour intimider ou « faire une leçon ») ;
- des feux stop défaillants non signalés empêchant la visualisation du freinage ;
- une manœuvre dangereuse ou imprévisible.
Important : Un freinage fantôme causé par un dysfonctionnement de l’AEB n’est pas considéré comme une faute du conducteur car il s’agit d’un événement involontaire et imprévisible. Dans ce cas, le conducteur suiveur, victime du freinage intempestif, reste protégé juridiquement.
Peut-on légalement désactiver les ADAS ?
Face aux désagréments ressentis par certains conducteurs (alertes intempestives, interventions jugées inappropriées), la question de la désactivation des ADAS se pose fréquemment.
L'état actuel du droit français
À notre connaissance, aucun texte spécifique n’interdit actuellement la désactivation temporaire des ADAS en France, sous réserve que :
- le système permette techniquement cette désactivation (ce qui est le cas pour la plupart des ADAS, excepté l’ABS et l’ESP),
- la désactivation soit temporaire (généralement réinitialisée à chaque démarrage),
- les systèmes fondamentaux de sécurité passive restent opérationnels.
Les risques juridiques de la désactivation
Attention toutefois, désactiver un ADAS peut avoir des conséquences juridiques :
- En cas d’accident : si l’enquête révèle qu’un système désactivé aurait pu éviter l’accident, cela pourrait constituer une faute du conducteur.
- Impact sur l’assurance : votre assureur pourrait invoquer une aggravation du risque ou une faute pour réduire ou refuser l’indemnisation.
- Contrôle technique : à terme, le fonctionnement des ADAS pourrait être vérifié lors du contrôle technique.
⚠️ Attention aux modifications permanentes
Toute modification permanente du système (reprogrammation, suppression définitive) pourrait :
- être considérée comme une modification non homologuée du véhicule,
- entraîner l’annulation de la garantie constructeur,
- poser des problèmes lors du contrôle technique,
- compromettre la prise en charge par l’assurance en cas d’accident,
- exposer à des sanctions pénales si la modification est jugée dangereuse.
L'évolution prévisible : vers les véhicules autonomes
Les systèmes ADAS actuels ne constituent qu’une étape dans un processus plus large : celui de l’automatisation de la conduite. Pour mesurer ce cheminement vers l’autonomie, la classification internationale de la SAE (Society of Automotive Engineers) distingue six niveaux, de 0 à 5.
Les six niveaux d’automatisation selon la classification SAE
- Niveau 0 : aucune automatisation, le conducteur exécute toutes les tâches de conduite.
- Niveau 1 : assistance ponctuelle, par exemple un régulateur de vitesse adaptatif ou une aide au maintien dans la voie, mais une seule fonction est automatisée à la fois.
- Niveau 2 : combinaison de plusieurs aides (ex. maintien dans la voie + régulation de vitesse adaptatif). Le véhicule peut gérer certaines tâches simultanément, mais le conducteur doit surveiller et rester maître du véhicule en permanence.
- Niveau 3 : conduite autonome conditionnelle : le véhicule peut gérer la conduite dans un environnement défini (par exemple, sur autoroute et à vitesse limitée). Le conducteur peut lâcher le volant, mais doit pouvoir reprendre la main rapidement en cas de besoin.
- Niveau 4 : autonomie quasi complète dans un périmètre défini (zone géographique ou conditions précises). Le véhicule peut circuler sans intervention humaine, mais pas dans toutes les situations.
- Niveau 5 : autonomie totale, sans volant ni pédales, dans toutes les conditions de circulation – un horizon encore très lointain technologiquement et juridiquement.
Le cadre juridique en France et en Europe
Dans l’attente d’une véritable autonomie, le droit s’est déjà adapté pour encadrer le niveau 3. En Europe, le règlement technique international UN R157 (ALKS – Automated Lane Keeping System) fixe les conditions d’homologation.
En France, le cadre légal existe depuis le 1er septembre 2022 (ordonnance n° 2021-443 et décret n° 2021-873) pour autoriser, sous conditions strictes, la circulation de véhicules dotés de systèmes de conduite automatisée. Cependant, leur déploiement concret reste limité, car :
- chaque modèle doit obtenir une homologation spécifique dans l’État membre,
- les conditions d’utilisation sont strictement encadrées (routes, vitesse, météo, etc.),
- les infrastructures doivent être adaptées pour garantir la sécurité.
Une évolution progressive et encadrée
Malgré les annonces médiatiques sur les « voitures autonomes », nous sommes encore loin d’un usage courant. L’évolution se fait par étapes : chaque nouveau palier d’automatisation soulève des questions juridiques essentielles (responsabilité en cas d’accident, partage des données de conduite, articulation avec les assurances).
👉 En pratique, les conducteurs doivent garder à l’esprit qu’aujourd’hui, les véhicules en circulation relèvent au mieux du niveau 2, et que la responsabilité juridique leur incombe toujours en cas d’accident.
L'adaptation nécessaire de la loi Badinter
La loi Badinter du 5 juillet 1985, qui constitue le socle de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, a été conçue pour un monde où le conducteur restait toujours maître du véhicule. Or, l’apparition de dysfonctionnements liés aux systèmes d’aide à la conduite de niveau 2, comme les « freinages fantômes », remet déjà en question ce cadre.
En effet, comment continuer à imputer la responsabilité au conducteur lorsque celui-ci subit une action automatisée et imprévisible déclenchée par son véhicule ? La frontière entre faute humaine et défaillance technique devient floue, ce qui montre que la loi devra évoluer pour intégrer ces nouvelles réalités, même avant l’arrivée hypothétique des véhicules totalement autonomes.
👉 Ce débat illustre que la révolution technologique des véhicules équipés d’ADAS entraînera aussi, à terme, une nécessaire évolution juridique.
Vos droits en cas de dysfonctionnement d’un système d’aide à la conduite (ADAS)
Un système d’aide à la conduite peut parfois présenter des défaillances, comme des freinages intempestifs ou des alertes injustifiées. Face à un tel dysfonctionnement, il est essentiel de réagir rapidement et de constituer un dossier solide.
Étape 1 : signaler et documenter le problème
Avant toute action, gardez une trace précise des incidents rencontrés :
- notez la date, l’heure, le lieu et les conditions de circulation,
- décrivez le comportement observé (ex. freinage brusque sans obstacle, alerte inappropriée),
- conservez si possible des preuves matérielles (photos, vidéos, témoins).
Ensuite :
- prévenez immédiatement votre concessionnaire et exigez un compte rendu écrit,
- adressez une réclamation au constructeur, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception,
- informez aussi votre assureur, afin qu’il tienne compte du risque en cas d’accident.
Étape 2 : faire valoir vos droits
Plusieurs leviers juridiques peuvent être utilisés selon la situation :
- La garantie légale de conformité (2 ans) : le véhicule doit être conforme au contrat et exempt de défauts.
- La garantie des vices cachés : si le défaut, non apparent lors de l’achat, rend le véhicule impropre à l’usage.
- L’action en responsabilité du fait des produits défectueux : si le dysfonctionnement a causé un accident ou des dommages.
- Le signalement à la DGCCRF : en cas de problème grave ou répété, pour déclencher une enquête auprès des autorités de contrôle.
👉 Il est recommandé d’être accompagné par un avocat en droit routier pour déterminer la stratégie la plus adaptée : négociation amiable avec le constructeur, expertise judiciaire, ou action en responsabilité.
L’importance des preuves techniques
En cas de freinage fantôme ou de tout autre dysfonctionnement, sachez que l’EDR enregistre automatiquement certaines données techniques (vitesse, freinage, activation de l’AEB, etc.) lors d’un accident. Ces informations pourront être exploitées lors d’une expertise ou d’une procédure judiciaire, et constituent un élément objectif de preuve.
Pour renforcer vos preuves au quotidien, l’usage d’une dashcam reste recommandé : elle permet de conserver une trace visuelle des événements et complète utilement les données techniques du véhicule.
Recommandations pratiques pour les conducteurs
Les systèmes ADAS offrent un réel confort et une meilleure sécurité, mais ils exigent aussi une vigilance accrue de la part des conducteurs. Voici quelques bonnes pratiques à adopter pour tirer parti de ces technologies sans en subir les inconvénients :
Se former et bien s’informer
- Prenez le temps de lire le manuel de votre véhicule, en particulier les chapitres consacrés aux ADAS.
- N’hésitez pas à demander une démonstration ou une formation lors de la livraison : c’est un droit pour tout acheteur d’un véhicule neuf.
- Familiarisez-vous avec les systèmes dans un cadre sécurisé (parking, route peu fréquentée) avant de les utiliser en conditions réelles.
- Suivez les mises à jour logicielles et les rappels constructeurs, car un ADAS mal calibré peut devenir source de danger.
Utiliser les ADAS avec discernement
- Gardez toujours le contrôle : les ADAS sont des aides, pas des pilotes automatiques. Votre vigilance reste indispensable.
- Entretenez les capteurs (caméras, radars, lidars) : un pare-brise sale ou de la neige peuvent perturber leur fonctionnement.
- Adaptez l’usage aux conditions réelles : par exemple, certains systèmes peuvent être moins efficaces par brouillard ou par forte chute de neige.
- Respectez les distances de sécurité, même si le freinage automatique d’urgence (AEB) est activé : la responsabilité en cas de collision reste la vôtre.
👉 En résumé, les ADAS doivent être envisagés comme un copilote électronique : précieux, mais qui ne remplace jamais votre jugement et votre responsabilité au volant.
Les ADAS représentent une avancée majeure pour la sécurité routière, mais ils ne sont pas exempts de défauts et soulèvent des questions juridiques complexes. La législation actuelle maintient fermement la responsabilité du conducteur, créant un décalage entre la perception de sécurité offerte par ces technologies et la réalité juridique.
Dans ce contexte en évolution rapide, la prudence reste de mise. Les conducteurs doivent comprendre que ces systèmes, aussi sophistiqués soient-ils, ne les déchargent pas de leur responsabilité. La vigilance constante demeure la meilleure protection, tant sur le plan de la sécurité que sur le plan juridique.
L’avenir nous réserve certainement une refonte du cadre juridique avec l’arrivée des véhicules réellement autonomes. D’ici là, les ADAS doivent être considérés pour ce qu’ils sont : des assistants précieux, mais faillibles, qui complètent sans jamais remplacer l’attention et le jugement du conducteur humain.
F.A.Q. Systèmes d’aide à la conduite (ADAS)
ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) désigne l’ensemble des systèmes d’aide à la conduite, comme le freinage automatique d’urgence (AEB), l’alerte de franchissement de ligne ou l’adaptation intelligente de la vitesse (ISA). Leur but est de renforcer la sécurité, mais ils ne remplacent jamais le conducteur.
Depuis le 7 juillet 2024, tous les véhicules légers neufs immatriculés dans l’Union européenne doivent être équipés d’ADAS comme :
- le freinage automatique d’urgence (AEB),
- l’assistance au maintien dans la voie (ELKS),
- l’adaptation intelligente de la vitesse (ISA),
- l’alerte de somnolence (DDAW),
- l’alerte avancée de distraction (ADDW, obligatoire à partir de 2026),
- l’enregistreur de données d’événements (EDR),
- le signal de freinage d’urgence (ESS),
- la détection en marche arrière et l’interface pour éthylotest antidémarrage.
En principe, le conducteur du véhicule suiveur est présumé responsable pour non-respect des distances de sécurité (article R412-12 du Code de la route). Toutefois, cette présomption peut être renversée si le freinage fantôme résulte d’un dysfonctionnement technique du véhicule qui précède.
Oui. L’EDR enregistre automatiquement certaines données techniques (vitesse, freinage, activation de l’AEB, etc.) en cas d’accident. Ces informations peuvent être exploitées dans le cadre d’une expertise judiciaire pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.
Oui, les dashcams sont légales en France. Leurs images peuvent être utilisées comme preuve par les assureurs ou devant un tribunal. En revanche, leur diffusion publique (réseaux sociaux, internet) est encadrée par le respect de la vie privée : visages et plaques d’immatriculation doivent être floutés.